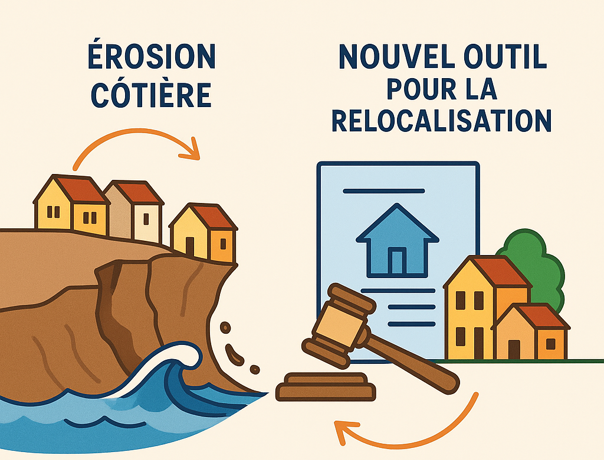Les communes littorales disposent désormais d’un outil renforcé pour la relocalisation
Face au phénomène d'érosion côtière qui touche 20% des côtes françaises, les collectivités locales disposent désormais d'un cadre juridique précis pour exercer leur droit de préemption spécifique. Le décret du 27 juin 2024 vient en effet définir les modalités d'application de cet outil créé par la loi Climat et Résilience, offrant aux communes littorales un levier concret pour organiser la relocalisation des personnes et des activités menacées.
Un dispositif ciblé sur les zones les plus exposées
Ce nouveau droit de préemption s'applique dans l'intégralité des zones exposées au recul du trait de côte à horizon de 30 ans, et facultativement sur tout ou partie des zones exposées à un horizon de 30 à 100 ans, sous réserve d'une délibération en ce sens de la collectivité concernée.
Le dispositif repose sur la liste des communes menacées par l'érosion, publiée par décret en avril 2022 et révisée en juin dernier. Ces communes doivent établir des cartes locales de projection du recul du trait de côte aux horizons de 30 ans et 30-100 ans, qui une fois intégrées dans les documents d'urbanisme, donnent accès aux nouveaux outils créés par la loi.
Des enjeux financiers considérables
Les projections du Cerema révèlent l'ampleur du défi financier : 1,2 milliard d'euros d'ici 2050 pour 5.200 logements et 1.400 locaux d'activités, et jusqu'à 86 milliards d'euros à horizon 2100 pour 450.000 logements menacés. L'absence de visibilité sur les modalités de financement des projets de relocalisation demeure toutefois un obstacle majeur à la concrétisation de cette démarche.
Des modalités d’application précises
Le décret du 27 juin 2024 reprend largement les dispositions du droit commun applicables aux autres droits de préemption. Il précise notamment :
Les conditions de publicité : affichage en mairie pendant un mois, publication dans deux journaux diffusés dans le département, et transmission aux services fiscaux, notaires et greffes des tribunaux.
Les modalités de délégation : la collectivité peut exercer directement ce droit, le déléguer à un acteur compétent comme un établissement public foncier (EPF), ou conventionner avec une Safer pour certaines situations.
Les procédures d'évaluation : une méthode spécifique d'évaluation des biens les plus exposés au recul du trait de côte à horizon de 30 ans, applicable dans le cadre de l'exercice du droit de préemption ou en cas d'expropriation.
Un objectif de renaturation avec usage transitoire possible
Ce droit de préemption spécifique permet d'acquérir des biens situés dans les zones concernées en vue d'assurer leur renaturation. Il offre également la possibilité d'autoriser "de façon transitoire", avant leur renaturation, par convention ou bail, un usage ou une activité compatible avec le niveau d'exposition du site.
Une hiérarchie des droits de préemption clarifiée
Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les autres dispositifs de préemption classiques (droit de préemption urbain, droit de préemption lié aux zones d'aménagement différé, droit de préemption commercial) ne s'appliquent pas. En revanche, ce nouveau droit ne peut primer sur le droit de préemption sur les espaces naturels sensibles.
Concernant les espaces agricoles, le droit de préemption spécifique au trait de côte prime celui des Safer, mais le législateur encourage la coopération entre les acteurs pour permettre aux parties de s'entendre en cas de préemption.
Des procédures encadrées
Le décret précise les modalités pratiques d'exercice du droit de préemption. La déclaration d'intention d'aliéner doit être adressée par le propriétaire à la commune en trois exemplaires par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique.
Le silence du titulaire du droit de préemption gardé pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration vaut renonciation à l'exercice de ce droit. Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire doit transmettre sans délai une copie de la déclaration au responsable départemental des services fiscaux.
Un outil au service de la recomposition territoriale
Ce nouveau droit de préemption constitue un élément clé de la politique de recomposition territoriale face au changement climatique. Il s'inscrit dans une démarche plus large d'adaptation des territoires littoraux, nécessitant une planification à long terme et une coordination entre les différents acteurs publics et privés.
L'efficacité de cet outil dépendra largement de sa mise en œuvre concrète par les collectivités locales et de la résolution des questions de financement qui demeurent en suspens. Il représente néanmoins une avancée significative dans l'arsenal juridique disponible pour anticiper et gérer les effets du recul du trait de côte sur les territoires littoraux français.